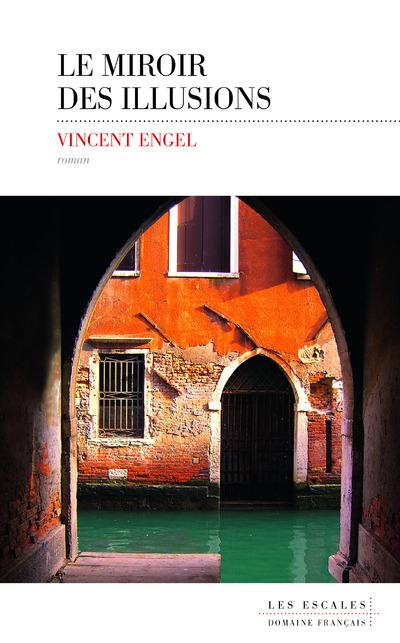LES PHRASES BELGES (8)
de Jean-Pierre Legrand et Philippe Remy-Wilkin
Chroniques en duo consacrées aux livres belges.
Un feuilleton en 6 épisodes consacré au « cycle toscan » de Vincent ENGEL
Episode 5
LE MONDE D’ASMODÉE EDERN
Quatrième tome : LE MIROIR DES ILLUSIONS
Ce feuilleton a débuté en avril 2023 avec le « romansonge » Raphael et Laetitia qui prologue le cycle. Il se poursuit le temps d’un semestre, à raison d’une analyse par mois, en évoquant les tomes réédités dès mai puis un 5e, inédit. Les éditions Ker et Asmodée Edern collaborent pour cette intégrale, lui offrant un nouveau nom : Le monde d’Asmodée Edern.
Jean-Pierre et Philippe, en fonction des épisodes, alterneront mise en place et contrepoints. Ils solliciteront à l’occasion des éclairages de l’auteur lui-même.
Pour Le miroir des illusions, Jean-Pierre est aux commandes, Philippe apportant ses contrepoints.
Éditions
Avant la présente réédition (460 pages), le livre a d’abord été publié par Les Escales/Lattès (Paris, 2016) puis dans la collection 10/18 (Paris, 2018).
Le pitch
Sur le site de l’auteur :
« Genève, 1849. Le jeune Atanasio, tout juste arrivé d’un petit village de Toscane, apprend le décès de don Carlo, son protecteur de toujours. Le notaire lui remet une lettre cachetée du défunt, accompagnée de cinq portraits. C’est le legs d’un père à celui qui ignorait être son fils. Un legs doublé d’une mission : venger don Carlo par-delà la mort, en assassinant, selon un protocole strict, tous ceux qui ont empoisonné son existence.
Quarante-neuf ans plus tôt, dans un palais du Grand Canal, Alba vient au monde. Radieuse et sauvage, elle grandit en se moquant des hommes comme de la morale, et n’entend pas changer de vie en épousant le prince Giancarlo Malcessati, alias don Carlo.
Mais une nuit, au coin d’une rue mal famée, surgit Wolfgang. L’Allemand s’éprend aussitôt d’Alba. Entre eux, pourtant, il s’agira moins d’adultère que de crime…
De Venise à San Francisco, en passant par Milan, Berlin et New York, voici les destinées romanesques de personnages guidés par l’obsession de la vengeance, au prix du bonheur, de l’amour et, peut-être, de leur vie. »
Suite… et fin ?
Quatrième volume du Monde d’Asmodée Edern, Le miroir des illusions présente, lors de sa parution initiale, toutes les apparences d’un point final apporté au cycle. En effet, depuis Retour à Montechiarro – et, avant celui-ci, le « romansonge » Raphael et Laetitia –, une énigme demeure. Elle est d’autant plus lancinante qu’elle constitue la pierre angulaire de tout l’ensemble. Quel est le sens de la malédiction qui, de livre en livre, semble poursuivre Raphael et Laetitia ? Et pourquoi donc la mère de celle-ci, Alba Macessati, s’oppose-t-elle avec un acharnement obsessionnel à l’union des deux jeunes gens ?
Le lecteur va enfin découvrir la vérité au terme d’un jeu de pistes haletant où, au gré d’indices trompeurs, l’on se fourvoie sans cesse : l’effet de surprise est maintenu jusqu’à la dernière ligne. On le sait maintenant, le cycle ne se referme pas pour autant : c’est Vous qui entrez à Montechiarro qui en sera la clôture, à la manière, écrit l’auteur, « d’une fin qui se veut recommencement ».
PHIL :
Une deuxième énigme concerne le devenir des deux amants mythifiés par le cycle et l’intensité de leur relation, son côté inexorable. Que leur est-il arrivé en Amérique ?
L’auteur, Vincent Engel, ne triche pas avec son lecteur. Après l’avoir pris deux fois à contre-pied (ce qui est la marque du respect et de l’art), dans Requiem vénitien puis Les absentes, il lui offre, quand celui-ci ne l’attend plus (et, donc, le prenant à nouveau à contre-pied), une vraie fin. Sauf qu’entretemps… un autre fil narratif s’est faufilé puis a pris le relais, et celui-là trouvera son épilogue dans le tome 5.
Mais…
Raphael et Laetitia ! La matière du « romansonge » est réintégrée ici, notamment le moment de la rencontre, du coup de foudre. Mais la problématique de leurs origines rebondit. Une autre originalité ? Vincent Engel ne nous offre pas un Raphael et Laetitia en Amérique, nous n’aurons accès qu’à des bribes de l’épopée. Il ne retrace pas non plus toute leur aventure amoureuse. Non, il choisit de reprendre l’affaire de ces amours loin en amont, à partir de l’histoire des parents de nos deux héros. D’ailleurs, Raphael et Laetitia ne sont même pas cités sur la quatrième de couverture, soit dans le résumé du récit retranscrit supra !
Premières impressions
Un cours prologue nous dévoile d’emblée la vengeance diabolique ourdie par le prince Malcessati alias don Carlo : quatre meurtres sont au programme imposé à celui qui apparaît comme son fils naturel. Cela sonne comme le début d’un opéra de Verdi, façon Simon Bocanegra. J’avoue être un peu inquiet : voici dès l’abord une barque bien lourdement chargée. Pourtant, passée cette première réticence, je suis pris par l’intrigue arachnéenne tissée par l’auteur. À chacun de ses mouvements, le lecteur s’empêtre davantage dans un mystère qui ne se dévoilera – en est-on d’ailleurs certain ? – qu’à la toute fin du roman. L’atmosphère générale est celle d’un véritable thriller.
Comme pour les volumes précédents, la construction est méticuleuse : encadré d’un prologue et d’un épilogue, le récit se déploie selon la division tripartite chère à l’auteur. Trois périodes temporelles strictement contiguës se succèdent de 1800 à 1853. La première (1800-1825) est centrée sur Alba, flamboyante et capricieuse jeune femme. Elle abandonne sur le carreau le prince Malcessati, son mari trompé et empoisonné, ainsi que Wolfgang von G***, son amant éconduit et laissé pour mort lors d’une meurtrière cavalcade. Peu adeptes du pardon des offenses, les deux hommes poursuivront la belle et ses deux enfants d’une vengeance diabolique. La deuxième période (1825-1849) constitue le temps long des machinations parallèles tramées par les deux mâles bafoués. Le dernier tour d’écrou donné à cette vengeance occupe les quatre dernières années (1849-1853). Toutes les pièces du puzzle sont ajustées avec une minutie extrême. On imagine l’auteur reportant sur une ligne du temps tous ses personnages et leurs éléments biographiques : les dates, les âges, tout est cohérent et il paraît impossible de prendre l’auteur en défaut. On devine qu’il a pris beaucoup de plaisir à monter ce mécanisme d’horlogerie.
Par rapport aux autres volumes du cycle, Le miroir des illusions présente une particularité : il est bien moins enraciné qu’eux dans l’Histoire, qui se limite ici à un décor d’arrière-plan même si, indirectement, les mentalités du temps, dont au premier chef la sujétion des femmes et la tyrannie du mariage, ne sont pas étrangers à l’engrenage qui se met en place.
PHIL :
Un « véritable thriller » et l’Histoire en retrait ? Avec Retour à Montechiarro, Vincent Engel avait réussi un roman complet (un futur grand classique de nos Lettres), à la fois romanesque au sens populaire (amours, vengeances, rebondissements, mystères), et littéraire (écriture, vision du monde, interrogations sur la vie, etc.). Il a pris la tangente de la littérarité dans le deuxième tome puis juxtaposé les deux manières dans le troisième. Ici, il joue à fond la carte du romanesque. L’Histoire n’est pas absente mais limitée : l’occupation française ; les différentes factions qui s’agitent dans les coulisses du devenir vénitien, représentées par les amants d’Alba.
Alba ! Elle est d’abord une vraie héroïne, malmenée par l’époque, les divers comportements masculins. Ses qualités vont progressivement déraper. C’est que tout excès dans un élan finit par générer son contraire :
« Elle l’avait effrayé par sa fougue désespérée, par une avidité qu’il ne lui connaissait pas, une violence des gestes, des morsures, des ongles plantés dans son dos, une manière de se cabrer, de crier, de mener la danse, effrayé et émerveillé en même temps, tandis qu’elle découvrait dans ce lit, ruisselante de sueur, dévorant le corps de son amant, combien elle s’était perdue, combien Venise lui manquait, combien son père avait dû être désespéré et épuisé pour croire qu’une vie avec Giancarlo la rendrait plus heureuse que l’existence qu’elle menait à Venise. ».
Chez Vincent Engel, chaque personnage a l’occasion de nous émouvoir et de nous mettre de son côté. Comme l’auteur le démontre, il suffit d’un rien pour basculer à droite ou à gauche :
« Notre destin ! C’est ce que nous serons devenus à défaut d’avoir été tout ce que nous aurions pu, si les circonstances avaient été différentes. »
Pour les gourmets avides du cycle complet, notons que l’Alba de ce 4e volet semble inspirée par l’Alba du 3e (qui vit en 1985). Engel multiplie les niveaux de lecture et offre des plaisirs étagés. Un auteur gastronomique ?
Des personnages aussi perturbés que perturbants
Au regard des 460 pages du roman, les personnages principaux sont peu nombreux. Ce resserrement sert fort bien la tension de cet implacable thriller. Outre notre vielle connaissance Asmodée Edern, nous découvrons deux nouveaux venus, Atanasio et Wolfgang von G***, et retrouvons quelques personnages à germination lente comme l’auteur en a le secret. Leur silhouette a passé ici ou là de manière fugace sans que l’on n’en apprenne grand-chose. Ainsi dans Retour à Montechiarro, Asmodée Edern sème à leur sujet quelques maigres informations qui lèveront plus tard :
« Giancarlo Malcessati ? Il est mort et je l’ai très peu connu. Vous devinez facilement combien sa femme (Alba) fut belle et intelligente, deux qualités qu’elle a d’ailleurs remarquablement conservées. Son père, Girolamo Acotanto, n’était pas un mauvais homme, mais un exécrable gestionnaire. Il a cru sauver sa fille du naufrage en acceptant ce mariage ; il ne se doutait certainement pas que cette union serait désastreuse. Par la grâce tardive de Dieu sait qui, Malcessati a entièrement disparu puisque, à l’évidence, pas une parcelle de lui n’est venue se mêler à l’élaboration du corps et de l’esprit de cette ravissante Lætitia. »
Plus loin, il ajoute qu’il ne sait « presque rien de la princesse Malcessati ». Ce quatuor de personnages va pleinement se déployer dans le 4e volet.
Girolamo Acotanto est le père d’Alba. C’est une figure paternelle dont nous avons déjà croisé quelques variantes dans le cycle. Dévasté par la mort de son épouse, c’est un père aimant mais triste, permissif par lassitude (une vie jalonnée de trop d’échecs et de meurtrissures). Bon mais faible et presque ruiné, il n’entrevoit pas d’autre solution qu’un mariage aux forts relents de maquignonnage pour sauver la position de sa fille Alba, jeune fille trop sûre du pouvoir de son exceptionnelle beauté, ivre de sa liberté et cruelle tantôt par désinvolture, tantôt par calcul. Elle a vécu jusqu’ici dans le mirage d’une aisance trompeuse et de rêves entretenus par son père. Le mariage avec le prince Malcessati, de vingt ans son aîné, maintient quelques années l’illusion d’une existence insouciante et brillante. Ses passions deviendront froides et calculées : « si la fougue s’en mêle c’est pour l’émoi de ses sens et de son corps, pour lesquels l’autre n’est qu’un adjuvant impersonnel ».
Giancarlo Malcessati est l’un des personnages les plus noirs du cycle. Passionné de chevaux – les seuls êtres qui ne l’ont jamais déçu –, c’est ce que l’on nomme aujourd’hui un « pervers narcissique ». Sa double identité civile (Malcessati/don Carlo) est allégorique de sa double personnalité plaisamment mondaine au grand jour mais férocement manipulatrice dans l’ombre de la vengeance.
Wolfgang von G*** est un « Goliath long aux traits fins et résolus, au regard franc et clair, mince et musclé ». « Mélange de force et d’abandon, de contrôle et d’impulsivité », il appartient lui aussi à la catégorie des manipulateurs. Sa douceur peut se lézarder de tensions inexplicables et son visage se défigurer d’une colère irraisonnée. Il porte en lui une violence terrible mais le plus souvent contenue. Ne serait-il pas, se demande Alba, « ce genre d’homme qui, privé de ses rêves, détruit tout plutôt que d’en laisser le fruit à d’autres » ? Tout jeune homme, il a empoisonné le mari de sa mère, qui s’apprêtait à le déshériter après que celle-ci lui eut avoué que leur fils n’était pas le sien. Wolfgang aussi se dédouble : il adopte la fausse identité de Hans Kapper.
PHIL :
Vincent Engel fait souvent écho à cette théorie qui m’est chère, celle des « artistes sans art ». Dont on parle ailleurs dans nos épisodes.
Atanasio est, par ordre d’apparition, le premier personnage du roman. Il découvre son ascendance supposée en même temps que nous, par la lecture des instructions que lui a laissées don Carlo, dont il serait le fils naturel, fruit de son amour pour une mystérieuse Maria, elle aussi décédée dans des circonstances énigmatiques. Confié par le prince à un couple de métayers, l’enfant a été élevé par eux, sachant qu’ils n’étaient pas ses parents mais dans l’ignorance de ses origines véritables. Son instruction a été confiée au précepteur Ludovico agissant sur les strictes consignes de don Carlo.
Quelques personnages secondaires fleurissent au fil des pages tels les époux von Rüwich, parents adoptifs de Raphael, Jacopo, l’amant vénitien d’Alba impliqué dans les réseaux carbonaristes et Ludovico. Ce dernier mérite une mention spéciale. Désigné précepteur d’Atanasio par don Carlo, il est la « voix de son maître », son régent. S’il arpente avec son élève les chefs-d’œuvre de la littérature, c’est au service d’une pernicieuse inversion des valeurs qu’illustre bien sa vision de l’Othello de Shakespeare. Pour ce pédagogue dévoyé, seul Iago fait preuve de courage et de détermination ; Desdémone est une traîtresse qui mérite de mourir. Sous les auspices du prince et de son affidé, l’éducation d’Atanasio relève d’un dressage dont les visées ont les relents des fascismes futurs : faire d’Atanasio un être à la fois fort et asservi qui, à l’instant propice, se fera l’instrument docile et implacable de la vengeance de son mentor.
PHIL :
Encore un invariant de l’œuvre engelienne : l’alternance d’utopies et de contre-utopies, de pédagogues idéaux (Asmodée, Ulisse, Baldassare, etc.) et infernaux.
Parmi les personnages secondaires, il y a Giovanni, le gondolier vénitien, l’ami d’enfance d’Alba. C’est peut-être le personnage masculin le plus positif et pur. On devine qu’il aime Alba mais il ne la force jamais, il la respecte, la protège et fondera un couple uni au côté d’une jeune femme simple et fiable aux antipodes de son amour impossible. Une sorte de contrepoint réaliste au couple idéalisé Raphael/Laetitia ? Contrepoint qui se répète dans le cycle, depuis le « romansonge qui le prologue.
J’ai laissé Raphael et Laetitia pour la fin…Les deux amants éperdus filigranent jusqu’ici tout le cycle toscan, qu’ils habitent en creux. Si le présent opus les donne davantage à voir, et singulièrement Raphael dans son enfance manipulée par Wolfgang alias Hans Kapper, ces deux personnages parfois me déconcertent. À la fois vent debout contre les convenances et la malédiction qui les poursuit, ils semblent à d’autres moments une cire molle sur laquelle s’imprime le cachet des événements provoqués par d’autres. Lorsque la machination qui menace de les broyer relâche son étreinte, ils s’abandonnent à une vie hédoniste et tranquille. Ainsi, à New York, où ils se croient à l’abri, les deux amants « vivent l’existence la plus insouciante et la plus heureuse qui soit. (…) Toute leur journée est organisée autour des loisirs et des plaisirs qu’ils y goûtent ». Cet éden dont ils sont constamment menacés d’être chassés semble être leur principal horizon.
Un roman de la manipulation et de la vengeance
La manipulation est inhérente à l’animal social que nous sommes au point qu’agir sans filtre aucun est souvent le signe d’un désordre psychologique ou d’une personnalité mal construite. Fréquemment, manipulation bien ordonnée commence par soi-même. Proust l’illustre admirablement dans La recherche. Contre toutes les évidences, Swann se convainc lui-même des qualités d’Odette jusqu’à ce que l’illusion qu’il a lui-même entretenue se dissipe sur un constat amer :
« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! »
Du reste, dans nos relations avec autrui, il est rare que n’entre pas une part de séduction dans la manière propre à chacun d’amener une personne à soi en la distinguant du groupe dans lequel elle se confond, en la persuadant, de bonne ou de mauvaise foi, qu’elle se démarque. Rien de très blâmable à tout cela.
Mais…
La séduction peut prendre un tour malsain lorsque l’autre est réifié, nié dans son identité. Il s’agit alors d’une séduction à sens unique où « le pervers narcissique cherche à fasciner sans se laisser prendre ». C’est exactement dans ce registre que s’inscrit Wolfgang von G***. Sous la fausse identité de Hans Kapper, il se rapproche de la famille adoptive de Raphael. Son but est de s’insinuer et de se ménager un ascendant croissant sur le jeune garçon en suscitant entre eux deux une forme de complicité admirative et confiante. Sa priorité est de « s’assurer le contrôle de Raphael pour faire de lui, en temps voulu, l’instrument de sa vengeance ». Et surtout, « en évitant de s’attacher ». La personnalité narcissique de Wolfgang se trahit dès sa première entrevue avec Raphael :
« (…) il avait été frappé par le physique de l’enfant qui lui avait paru le portrait craché de sa mère, alors qu’il peinait à y retrouver ses propres traits. (…) Pour lui, cette physionomie sombre et solaire à la fois était le fruit de l’implacable volonté d’Alba et de son caractère dont il avait découvert la part terrifiante : elle avait réussi à nier l’amour de Wolfgang. »
Outre qu’elle est l’instrument d’un châtiment préparé de longue main, l’emprise que Wolfgang se ménage sur le jeune garçon a peut-être aussi une autre visée : effacer du visage de l’enfant les traits de sa mère en imprimant dans son regard une aimable image de lui-même. Cependant, la motivation principale est la vengeance :
« (…) le seul sentiment qui puisse dominer votre vie au point que celle-ci n’ait plus de sens en dehors de celui-là, au point que toutes vos actions et toutes vos pensées soient dictées par ce sentiment. »
De toutes nos passions, la vengeance seule peut durer aussi longtemps qu’une vie.Elle est, écrit très justement Vincent Engel, « la volonté désespérée d’abolir le passé, d’annuler ce qui avait eu lieu, ou du moins lui substituer un acte aussi violent qui rétablirait l’équilibre ».
Spéculaire et donc narcissique dans la mesure où le vengeur instaure une relation duelle où il reproduit en miroir ce que l’autre est censé lui avoir fait subir, la violence vengeresse est aussi profondément érotisée. C’est manifeste dans le cas d’Atanasio : il est hanté par la scène violente et humiliante de sa première expérience sexuelle, son souvenir traumatique imprègne ses jouissances les plus sadiques. La dimension érotique de la vengeance en est à la fois l’adjuvant le plus capiteux et la limite la plus déceptive : elle ne survit pas à son assouvissement. Wolfgang alias Hans en fait l’amère expérience :
« Alba était morte. La nouvelle avait stupéfié Hans et l’avait laissé accablé. Il avait cherché à se ressaisir, à se moquer de lui : n’était-ce pas ce qu’il avait cherché toutes ces années durant ? La vengeance ! Elle était venue, cette heure à laquelle sa vie avait tenu, autour de laquelle toutes ses pensées, tous ses gestes s’étaient organisés. Regrettait-il de n’avoir pas été l’artisan de cette mort ? Non. Elle le laissait comme veuf de sa haine, de sa rage. Avait-il espéré nourrir ses dernières années du dépit d’une femme défaite, solitaire dans son palais, ressassant ses échecs et redoutant le coup fatal venu d’outre-tombe la punir de ses fautes ? Sans doute oui, quelque chose de cette sorte. Un dessein qui aurait reculé de quelques années l’impression de vacuité absolue dans laquelle il se retrouvait. »
Cet écueil, don Carlo a trouvé le moyen de le contourner. Tout à son idée fixe de punir ceux qui lui ont fait tort, le prince a compris que la jouissance de la vengeance est davantage dans le chemin tortueux qui y mène que dans sa réalisation : il ne faut donc pas en hâter le terme :
« Contrairement à lui (Wolfgang), Giancarlo n’aimait pas tant la résolution de la vengeance que sa construction. Celle-ci ne procurait qu’un long et savoureux frisson, une excitation continue comme dans l’étreinte la montée vers la jouissance ; on se vengeait comme on aimait, on caressait son projet comme la peau de sa maîtresse, on sophistiquait son plan comme on découvrait de nouvelles sources de plaisir. Mais, après la jouissance, une fois vengé, on ne se retrouvait pas, essoufflé, au côté d’un être aimé et nu, mais debout, solitaire et vêtu de deuil, devant un cadavre. Le deuil que l’on portait était celui-là même de sa vengeance, de ce qui avait aidé à vivre. »
Don Carlo a donc choisi de mourir avant ce « sombre orgasme ». Cela en fait le plus pervers des trois personnages criminels du roman : son seul plaisir est de faire souffrir ceux que sa haine désigne et dont il guide les pas vers un dénouement tragique dont ils ignorent tout de la part qu’ils y ont prises eux-mêmes. Sa mort ne marque pas le terme de son projet criminel mais constitue au contraire le point de départ de son exécution concrète. En la personne d’Atanasio, il s’est choisi un exécuteur, un ange exterminateur. En guidant son éducation, don Carlo s’est assigné un seul but : transformer Atanasio en un bourreau insensible, dépourvu de tout attachement. L’aliénation du jeune homme est profonde : il a parfaitement la possibilité de refuser la mission qui lui est confiée ; il l’accepte pourtant sans la moindre hésitation.
Vincent Engel m’a confié que l’une des scènes les plus démoniaques du roman s’inspirait de pratiques réelles d’éducation des jeunes SS. Ceux-ci se voyaient offrir un chien qu’ils étaient chargés de dresser. À la première incartade de l’animal devenu leur meilleur compagnon, ils avaient ordre de l’abattre. Cette anecdote, directement transposée dans le roman, illustre de manière éclairante un mécanisme psychologique bien identifié par la psychanalyse : l’incitation au sadisme. Ce n’est pas pour rien que la figure de Iago est abordée avec insistance dans la partie du roman relative à la formation du jeune Atanasio. Comme l’écrit Steven Wainrib, le « couplage Iago-Othello » est un modèle d’induction du sadisme. Iago s’empare du psychisme d’Othello en suscitant et utilisant sa détresse. Don Carlo agit de même : il cultive chez Atanasio l’angoisse concernant son image, sa capacité à être aimé de manière à le placer sous son absolue dépendance en suscitant un sentiment de fidélité aveugle.
En faisant de la vengeance un point central de son roman, Vincent Engel s’inscrit dans une longue tradition littéraire dont Le comte de Monte-Cristo n’est pas le moindre représentant. Vincent Engel admire Alexandre Dumas ; d’ailleurs, Dantès est directement évoqué à plusieurs reprises dans le roman suivant du cycle.
Tout comme chez Edmond Dantès le désir de vengeance de Malcessati et de Wolfgang von G*** n’a rien d’étonnant : il s’origine dans une atteinte délibérée à leur vie qui ne relève nullement d’un fantasme délirant ou d’une paranoïa quelconque. Ce qui est plus surprenant, c’est la démesure du passage à l’acte qui, particulièrement pour Malcessati, est sans proportion avec l’outrage subi. À l’instar du héros de Dumas, tous les deux souffrent une véritable Passion et reviennent d’entre les morts pour juger les vivants. Chacun est animé d’un sentiment de toute-puissance qui le place au-dessus de l’humaine condition et l’autorise, comme le dieu de l’Ancien Testament, à faire retomber les fautes des pères – ici des mères – sur leurs enfants. Ce qui distingue ces personnages, c’est leur rapport au doute. Wolfgang von G***, comme Dantès, en vient à douter de la légitimité de sa vengeance et de la pertinence d’y avoir assujetti presque toute sa vie d’homme. Don Carlo est effleuré par ce sentiment mais il s’en est prémuni par avance : un autre exécutera, après sa propre mort, la sentence qu’il a prononcée.
PHIL :
Les deux vengeurs/manipulateurs (Carlo et Wolfgang) sont placés dans une singulière symétrie, chacun formatant avec un cynisme ignoble un disciple enamouré (Atanasio et Raphael) et chacun aboutissant au même carrefour de l’accomplissement, du doute et du renoncement. Reste à voir si la symétrie se poursuivra jusqu’au bout ou si les voies finales empruntées seront contrastées.
Où l’on reparle des champignons
Nos actes sont aussi mystérieux que nos pensées. Leur motivation réelle nous échappe, la raison de leur surgissement soudain nous demeure obscure. Que dire alors de leurs conséquences ? Notre vie est tissée de bifurcations, de ruptures inattendues, de rebonds et sursauts. Face à cette inextricabilité des causes et des conséquences, la métaphore des champignons éclot dès Retour à Montechiarro :
« Des champignons, s’exclame Asmodée Edern, (…) essayez d’en cultiver, vous ne produirez au mieux que d’insipides morceaux de caoutchouc. Il n’est pas possible de prédire avec précision où et quand surgiront les plus savoureuses et les plus rares espèces ! Car ce qui jaillit de terre et dont nous nous délectons – quand c’est comestible – n’est que le stade ultime d’un processus souterrain largement incontrôlable. Le mycélium s’étend, se ramifie, se cherche un autre mycélium. Tout à coup, la rencontre se produit. Si la chaleur et l’humidité idoines s’en mêlent, le fruit bondit de terre en un jet victorieux. On l’attendait ici, il jaillit là ; on le voulait aujourd’hui, il ne viendra que demain. Le champignon est enfant de bohème… Ce mycélium qui s’étend, c’est notre volonté, notre pouvoir ; quand l’union est harmonieuse, quand les forces se complètent, se conjoignent en un pouvoir qui construit, le champignon est succulent ; quand l’un domine l’autre et accapare sa force pour bâtir un pouvoir qui contrôle et domine surgit l’amanite phalloïde ! ».
La rencontre des mycéliums est à l’image de nos destinées : elle relève de lois qu’à défaut de les connaître nous nommons « hasard », « coïncidence » ou encore « providence ». Elle est imprédictible pour la seule raison qu’un certain nombre de ses variables nous resteront toujours inconnues.
Asmodée Edern s’apparente à un ange gardien à la bonté facétieuse : il aime susciter des rencontres et prendre le risque qu’elles ne se produisent pas. Il ne se prétend pas l’incarnation du Bien : il n’est ni Dieu ni l’un de ses saints ; sa spiritualité se passe de religion mais aussi de divinité. La souffrance lui est odieuse comme une obscénité dans laquelle ne gît aucune rédemption. Asmodée ne se résout pas à ce que « l’arbre de nos possibles pousse à l’envers ». Une dimension spinoziste colore sa volonté incessante de susciter les bonnes rencontres et de favoriser chez chacun la capacité à persévérer dans son être le plus authentique : la vie, pour lui, devrait être un déploiement et non un repli progressif. À l’inverse, don Carlo campe sur le versant maléfique de la théorie des mycéliums. Elle fonde sa stratégie du mal. Dans sa lettre cachetée déposée chez le notaire à l’attention d’Atanasio, il écrit :
« Depuis des années, j’ai posé des actes qui sont autant de mycéliums lancés dans l’aléatoire relatif de l’existence. Tu es l’un d’eux. Il y en a d’autres et j’ignore les fruits que produiront vos rencontres futures. Je l’ai voulu ainsi. Ce que je sais : l’introduction de ton mycélium sera déterminante, un puissant automne dans un sous-bois gorgé d’espérance et de désespérance, bientôt couvert de champignons à la comestibilité encore indéterminée. Cela me suffit ; je ne veux plus laisser au réel la chance de me décevoir. Et pour ce qui est du poison, j’en ai absorbé assez pour me pourrir le corps et m’ôter tout espoir d’échapper à la plus misérable et effroyable fin, dont l’accident qui m’a cloué sur cette chaise et poussé à rédiger ce testament est une péripétie majeure. Je n’ai pas tout laissé entre les seules mains du hasard et c’est la raison de mon autre passion, qui n’a jamais manqué de t’intriguer. Lorsque je t’amenais auprès des enclos où caracolaient mes chevaux. »
La métaphore des mycéliums se conjoint ici à celle des chevaux, la seconde passion de don Carlo. Ce sont des animaux que l’on dresse et dirige. Il présente d’ailleurs les cinq portraits qui accompagnent sa lettre cachetée comme ceux de cinq chevaux que, par-delà sa mort, il fantasme de conduire, comme à la longe, vers le drame final. Revendiquée avec le même entrain par Asmodée Edern et don Carlo, l’image des mycéliums ne serait-elle pas aussi une allégorie de l’ambivalence de toute théorie, que chacun peut tirer à soi selon ses propres visées ?
Tristan et Yseult
Alors que Wolfgang la presse de s’enfuir avec elle, Alba s’interroge :
« Bien sûr, elle aurait voulu comme Wolfgang n’être qu’à deux, affranchis, et à Venise ; mais avait-il songé à Tristan et Yseult, qui se retrouvèrent libres et pour ainsi dire nus dans la forêt après que le roi Marc les eut chassés, et qui finirent par ne plus supporter l’ennui de cette vie qu’ils avaient crue idyllique ? »
La réponse de Wolfgang fuse :
« Tristan et Yseult n’ont pas été à la hauteur de leur amour. »
Ce renversement du mythe de l’amour absolu a de quoi surprendre. Mais, à la vérité, rien dans la vie ne peut être à la hauteur de cet amour. Tristan et Yseult s’aiment, c’est entendu, mais que dire de plus ensuite ? Répéter en boucle, comme le suggère Michel Zink, le mot « amour » ? Dans la vie, nous souffle François Mauriac, « Tristan et Yseult parlent du temps qu’il fait, de la dame qu’ils ont rencontrée le matin, et Yseult s’inquiète de savoir si Tristan trouve le café assez fort ». Libre, violente, excessive, passionnée ou désespérée mais sachant au besoin tenir ses émotions à distance, Alba ne veut rien de tout cela : ni l’amour serein de deux amants légitimes ni sa dégradation en un banal adultère. Alba est décidément un personnage complexe. L’évocation d’Yseult m’a immédiatement fait songer, par contraste, à La plage d’Ostende de Jacqueline Harpmann. Son héroïne, Émilienne, décrit ainsi le sortilège de son amour pour Léopold :
« Tristan enchaîne Yseult en apparaissant et la dépossède de soi. Je n’ai rien décidé : une fois vouée, je me suis rendue à l’appel de la vocation, et Léopold n’a pas choisi. Il se serait défendu s’il l’avait pu. »
Alba est à l’extrême opposé de cette attitude. Très tôt, cette dépossession de soi, elle la ressent comme une menace. Plus encore lorsqu’elle se mue en une emprise la conduisant sur la pente du crime. Plus jamais ensuite elle n’aura d’autres amants que de passage.
L’ombre de Tristan et Yseult s’étend à Raphael et Laetitia, tant c’est aussi un philtre d’amour qui semble les avoir précipités dans les bras l’un de l’autre. Hans Kapper n’a rien négligé pour forger les inclinations de Raphael et rendre, le moment venu, l’attrait de Laetitia irrésistible : pendant plus de vingt ans, il a « instillé chez le jeune homme un poison subtil », « l’a à jamais rendu insensible aux beautés septentrionales et asservi, comme le philtre l’avait fait pour Tristan et Yseult, à cette beauté pour laquelle son cœur avait été patiemment façonné ». Ce couple s’oppose trait pour trait à celui, diabolique et éphémère, d’Alba et de Wolfgang.
L’amour et la haine
L’amour et la haine ne sont pas si éloignés qu’ils paraissent, opposés mais contigus. On passe d’autant plus aisément de l’un à l’autre qu’ils obéissent à des lois semblables. Wolfgang von G*** en est la parfaite illustration. Rejeté par sa maîtresse, il transpose dans ses relations avec l’enfant, mais en la renversant, l’asymétrie de ses sentiments amoureux. L’amour que l’enfant lui témoigne devient le support de sa haine :
« Il avait découvert, à travers ces années, que la haine était aussi difficile que l’amour, et aussi dévorante. Mais peut-être aussi nourrissante, capable de combler un homme ou une femme, et de lui faire oublier tout le reste – surtout quand ce reste pesait si peu. Aimer quelqu’un qui ne vous aimait pas ou qui ignorait tout de votre amour était une douleur, une souffrance que l’amoureux transi prenait souvent plaisir à maintenir, car le sentiment sans écho, le don sans réciprocité est préservé de l’usure et de la déception. L’autre demeurait inaccessible, sans doute, mais inaltéré, soumis à l’image que s’en était forgée l’aimant. Dans la haine, Hans avait retrouvé la même alchimie terrible : haïr quelqu’un qui vous aimait, ou quelqu’un qui ignorait tout de votre sombre passion. »
Wolfgang alias Hans traîne aussi avec lui une enfance toxique – meurtre du père légitime, suicide de la mère – dont il espérait guérir dans les bras d’Alba. Ses relations avec elle s’en ressentent : la chaîne rompue de l’amour maternel a contribué à une personnalité inaboutie ivre d’un désir de fusion et de contrôle. Certes, l’élément déclencheur de sa vengeance est la trahison d’Alba mais on subodore que la frustrante impossibilité d’une union totale avec l’autre, que chacun expérimente dans sa vie, ne pouvait chez cet être incomplet mener qu’au langage de la violence.
L’inceste
Depuis les premières pages du cycle, le soupçon d’inceste pèse sur Raphael et Laetitia. Sont-ils demi-frère et demi-sœur ? Nous ne dévoilerons pas ce secret. L’important c’est que tous deux acquièrent en chemin la certitude du lien de sang qui les unit.
Avec des variantes importantes, l’interdit de l’inceste est présent depuis des millénaires dans toutes les cultures et singulièrement dans la culture chrétienne, qui en a élargi le périmètre. Dans ce contexte, Raphael – davantage que Laetitia – affiche une conception très singulière du tabou universel :
« Quels terribles secrets abritent les familles ! Pour autant, cela modifiait-il quoi que ce soit à l’amour qui nous liait ? Depuis la naissance de son fils en Toscane, Lætitia savait qu’elle ne pourrait plus enfanter ; et ce qui avait terni notre joie apparaissait désormais comme un signe du destin bénissant notre union. Mais Lætitia partagerait-elle cette vision ou, terrifiée par le poids du tabou majeur, me rejetterait-elle ? »
Subrepticement, Raphael tourne le dos à la condamnation sociale et culturelle de l’inceste pour n’en retenir que les conséquences biologiques : la stérilité supposée de Laetitia bénit leur union. D’absolu, l’interdit se fait plus relatif.
Il est toujours amusant et instructif de repérer les parallèles entre la fiction et la réalité. À côté d’un bienvenu durcissement de la condamnation de l’inceste, la jurisprudence récente présente elle aussi certains accommodements tout aussi légitimes. Ainsi, en 2017, alors que la loi ne permet pas à deux individus de reconnaître leur enfant s’il est issu d’une relation incestueuse, la Cour d’appel de Caen a refusé de faire disparaître l’un des deux parents de l’acte de naissance d’une petite fille, dont le père et la mère ont découvert après la naissance qu’ils étaient demi-frère et demi-sœur.
Sous le regard d’Antigone
Antigone est citée à huit reprises dans le roman. Chacun connaît ce mythe introduit par Sophocle et le théâtre grec. Antigone est née de l’inceste involontaire entre Œdipe, fils de Laïos, et Jocaste, reine de Thèbes. Elle est donc à la fois fille et sœur d’Œdipe. Elle est aussi la sœur d’Étéocle, Polynice et Ismène, les autres enfants d’Œdipe et de Jocaste.
À la mort de leurs parents, Etéocle et Polynice se partagent le pouvoir sur Thèbes : ils seront rois à tour de rôle, une année sur deux. Au terme de la première année, Étéocle refuse de céder la place à Polynice, qui déclenche alors la guerre avec le secours d’armées étrangères. Les deux frères s’entretuent et le pouvoir échoit à Créon, oncle d’Antigone. Pour assoir son autorité, Créon ordonne des funérailles grandioses pour Étéocle et refuse toute sépulture au traître Polynice dont la dépouille sera abandonnée aux corbeaux. Antigone ne peut accepter que l’âme de son frère soit condamnée à une errance éternelle. Elle projette d’ensevelir son frère en secret avec l’aide de sa sœur Ismène. Prudente, celle-ci refuse. Antigone agira donc seule. Après une première tentative avortée, Antigone est arrêtée. Créon qui répugne à supplicier sa nièce lui enjoint de renoncer. Antigone s’obstine au nom des lois non écrites qui s’imposent à la conscience de tous. Elle est donc condamnée à mort.
Intransigeante, ivre d’absolu, généreuse et cruelle, fascinée par la mort, Antigone a pu être qualifiée de « diamant noir ». C’est un personnage ambigu. Il n’est donc pas surprenant qu’elle inspire des personnalités aussi différentes qu’Alba et Raphael. Sans doute l’inflexible Alba voit-elle avant tout en Antigone le symbole d’un refus de l’oppression masculine et d’une intransigeance sans partage qui correspond bien à sa personnalité rebelle et parfois capricieuse. On n’est pas étonné que ce soit par la musique de Mendelssohn que Raphael, au naturel plus doux, soit éveillé au mythe d’Antigone. Lui, qu’une éducation largement orientée par Wolfgang incline davantage à la soumission, se dévoile à lui-même lors de l’écoute de cette magnifique musique de scène. Pourtant plus proche de la prudence d’Ismène, il est touché par une forme de révélation qui change peut-être – à l’instar, chez les mycéliums, du plus ou du moins de chaleur à un instant donné – le cours de sa vie :
« Mais il est des circonstances où on ne peut pas être prudent, n’est-ce pas ? Quand je dis que l’on ne peut pas, je pense qu’on a même l’obligation de ne pas l’être. L’imprudence est parfois la seule réponse à l’injustice. »
Le refus d’Antigone et la révolte camusienne se rejoignent.
La consolation de l’art
Asmodée Edern surgit le plus souvent dans la vie des personnages du cycle à un moment de souffrance, d’équilibre instable, de crise, de doute existentiel, de bifurcation possible vers le Bien ou le Mal. Alors, il emmène le pauvre égaré devant les toiles de Véronèse, Titien ou Tintoret, avec une prédilection pour ce dernier, le plus indépendant et le plus rebelle des trois. Qui, par ses audaces et la sensualité cachée de ses toiles, nous suggère que l’on ne peut pas vivre uniquement de prières et d’élévation ; « il nous faut aussi le contact d’une peau contre la nôtre ».
J’ai toujours, dit Asmodée, « considéré que le spectacle de l’art était le plus puissant des réconforts. L’art se construit souvent sur la souffrance et l’ordure, qu’il distille en beauté. Et notre émotion tient autant dans la splendeur que dans le souvenir de l’horreur ». Dans un monde lacéré de souffrances, l’art témoigne que du pire peut sortir le meilleur. Il nous met aussi subtilement en garde contre les puritanismes et fanatismes de tout ordre. Un autre monde est possible si nous ne renonçons pas à la lutte acharnée pour la beauté.
Conclusions
« Mais la vengeance a-t-elle jamais consolé d’un amour perdu ? » Rarement épigraphe a été mieux choisi : tout le roman en découle et y aboutit. Mené comme un thriller dont le suspense ne faiblit à aucun moment, le roman explore les affres de la vengeance et le mécanisme de l’emprise. L’entrecroisement des destins, le dédoublement des identités et les généalogies tourmentées auraient pu perdre le lecteur. C’était sans compter avec une passion d’enfance de Vincent Engel : le jeu de Lego ! La construction du récit est joyeusement complexe et totalement imparable. Le plaisir de la lecture est constant comme dans les meilleurs Dumas.
PHIL :
Il y a quelque chose de l’effet Rashomon dans ce livre. Comme dans le film de Kurozawa, qui a été précédé par La pierre de lune de Wilkie Collins (pour moi, le plus grand roman romanesque du 19e siècle), nous percevons le récit différemment au gré des angles offerts par les différents protagonistes. Ainsi, auprès de don Carlo, nous percevons Alba comme un monstre, une de ces femmes fatales des films noirs américains. Mais de la découvrir ensuite enfant puis adolescente à Venise chamboule la perspective.
Manipulation et vengeance ! Ces deux thématiques sont si présentes, absorbantes, et si sombres, qu’elles induisent mon bémol à propos de ce 4e volet. À y regarder en surplomb, les autres volets voient la lumière s’infiltrer à travers les ténèbres. Asmodée, Baldassare, Bonifacio, Ulisse, Agnese, etc. déposent des touches de sublime sur la noirceur du monde. Ici… Même les amours de Raphael et Laetitia mettent parfois mal à l’aise…
Mais…
Mon bémol se situe a posteriori de ma lecture du cycle entier et en comparaison des autres pans de l’ensemble. Un hasard a voulu que je lise Le miroir avant les 3 premiers tomes. Ma première lecture (en fin 2022) avait été très positive. Dans un premier article, sommaire, paru en janvier 2023 dans Les belles phrases, j’avais décrypté toutes les lignes de force de l’auteur, perçu, très ému, de nombreuses convergences avec mes prédilections de lecteur, d’auteur :
« Le nombre de pages, les années qui défilent, le titre, les décors (Venise et ses palais déliquescents, ses gondoles et ses ponts, Milan et son opéra, l’Allemagne, les États-Unis, Genève), les thématiques (la vengeance, l’amour passion), l’époque (19e siècle), la bande sonore (Liszt, Schubert, etc.), tout concourt à nous transporter dans un univers d’un autre temps, qui croiserait Balzac et Dumas. Il fallait oser aller à contre-temps tout en échappant aux écueils de l’entreprise, en modernisant l’ensemble en douceur, en privilégiant une grande fluidité de langue et de mouvement. Au large les digressions pesantes et les descriptions trop longues ! Toute la place est offerte aux personnages et aux trames qui les connectent, les décors et les atmosphères sont esquissés à la manière d’un coup de crayon d’Hugo Pratt, un pointillé laissant notre imaginaire compléter le tableau à partir de nos réminiscences de films, de documentaires. »
Ah ! Encore !
Toute l’œuvre de Vincent Engel est peuplée d’échos, de signes. Volontaires et donc conscients pour la très grande majorité, bien sûr. Mais… Vouloir contrôler et créer la magie est peut-être dangereux, elle pourrait quitter les pages et s’insinuer dans la vie. Pour le pire, ou pour le meilleur. Et donc… ? La femme du gondolier Giovanni, qui figure dans le récit l’épouse réelle, la moitié d’un couple qui vivra tranquillement sa vie, hors dérives du rêve, de l’ambition, de la jalousie, etc., et prolonge le contrepoint conjugal du « romansonge » initial, s’appelle Lucia. Comme le personnage qui clôt le 5e tome (publié en 2023), en écho à la compagne actuelle de Vincent Engel, Lucie. Celle-ci lui a ouvert une nouvelle et heureuse tranche de vie, mais… avant 2016, lors de l’écriture du Miroir, il ne la connaissait pas. Prémonition ?
En off, l’auteur, alerté, s’amuse de mon trouble et l’aggrave : il a rencontré sa Lucie après l’écriture d’un ouvrage pour la jeunesse, Et si Lucie…, publié en 2019. Prémonition !
Pour accéder à nos premières investigations sur le « cycle toscan » et sa matrice…
Les quatre premiers épisodes de notre travail en duo sur Vincent Engel se trouvent dans notre revue en ligne Les phrases belges :
https://lesbellesphrases264473161.wordpress.com/category/les-phrases-belges/
Jean-Pierre Legrand et Philippe Remy-Wilkin.
= = = = = = = = = = = = = = = =