 par Philippe LEUCKX
par Philippe LEUCKX
 Annie Ernaux, que « La Place », « Journal du dehors » ou autres « Les Années » ont rendue célèbre, et à juste titre, tant on adhère à cet univers aigu, entre remémoration familiale, acuité sociologique pour percevoir l’autre et écriture splendide de densité vraie, publie au Seuil son journal d’Auchan.
Annie Ernaux, que « La Place », « Journal du dehors » ou autres « Les Années » ont rendue célèbre, et à juste titre, tant on adhère à cet univers aigu, entre remémoration familiale, acuité sociologique pour percevoir l’autre et écriture splendide de densité vraie, publie au Seuil son journal d’Auchan.
Le temps d’une année, à raison d’une visite tous les 4 ou 6 jours, l’écrivaine a pris l’hypermarché comme lieu, thème et écriture d’une exploration sociologique. Décrivant au plus près les décors, les intervenants (clients, caissières), les comportements, retranscrivant dialogues et faits divers, Annie Ernaux poursuit son travail d’ethnographie du quotidien.
C’est Cergy, son lieu de vie, bien sûr, c’est Trois-Fontaines, c’est Auchan, avec ses verrières reflétant d’un côté les nuages, et de l’autre son aspect funèbre et désolant.
Rien n’échappe à l’acuité foncière de celle, qui depuis « La place », n’a cessé de penser à la sienne, face aux autres, parallèlement aux autres, dans la vie des autres. En cela, faire paraître ce volume mince mais si essentiel dans la collection « Raconter la vie » prend sens et légitimité. Qui d’autre qu’Annie – à la tristesse insigne qui vous prend à la gorge, que j’ai vue à Bruxelles, lors d’une Foire du livre, si belle et si mélancolique, dont la beauté des livres se lit sur son visage, cœur dévasté, empreint d’une dignité exemplaire et forcément partageable – pouvait parler de ces vies communes, quotidiennes, banales dans un hypermarché qui réglemente les vies, les contraint, les révèle à leur extrême pauvreté ?

Pour Ernaux, l’hypermarché, autant que l’école, cloisonne, sépare, tout en livrant une part de découverte. On ne lit pas Ernaux impunément, comme on lirait un roman – allons, ne soyons pas méchant, disons de cette romancière Nothomb -, on lit la vie sous le style unique – phrases courtes, incisives, qui n’enjolivent jamais, mais décodent sans cesse les réalités multiples -, avec un regard de photographe sensible. En 64 pages, elle réussit l’exploit de photographier au plus juste les structures d’une grande surface, par paliers, blocs, étages, en rappelant les règles d’une société basée sur le profit, le consumérisme galopant, les invectives, les interdictions : Auchan ne cède en rien ni sur le matraquage à la consommation ni sur la portion congrue réservée à la presse de qualité ni sur le régime imposé aux travailleurs. Annie débusque au plus vrai ce à quoi sert ce grand commerce sous verrière : à contenir tous les désirs, à les voir prospérer en étalages, en montagnes de produits.
Mais, au-delà du profil économique dressé, c’est l’humain qui prime chez elle : dire le peu vécu par les gens du peu économique, dire la souffrance de ce qui n’est pas possédé, évoquer ce croisement impossible de certaines tranches de la population au sein de l’hyper, donner à voir l’ordinaire de nos vies, ramassées sur des attentes, des manques, des envies, des gestes. Jamais, l’auteur ne juge. Elle décrit, observe, cite des chiffres, se réfère à la presse, analyse, rappelle, rameute le passé pour éveiller à la connaissance du présent, saisit les données d’apparition, d’émergence des grandes surfaces et de leur impact sur la vie des Français dans un lieu circonscrit, connu, longtemps fréquenté.
Les anecdotes sont si prégnantes qu’Ernaux les élève au statut de scènes inoubliables. Miracle d’une écriture qui ne banalise jamais mais fait écho de sens et de cœur avec les personnes rencontrées d’un côté ou de l’autre des caddies. On retient la caissière craintive de perdre son emploi pour un contrôle ou le caissier tout content d’échapper à la corvée fatigante des mises en rayons ou l’anonyme perdu avec son cabas de désolation ou les fameuses caisses automatiques qui donnent l’impression d’être sans cesse surveillés…
Au-delà des petits faits, on n’est pas loin de la dénonciation d’Aubenas (à propos des boulots précaires), on assiste à « l’extension de mon univers intime » d’un auteur qui prend place et corps et cœur dans l’univers dématérialisé et si matérialiste d’Auchan. Les enfants, les mères, les femmes, comme chez Aubenas, trouvent ici une place de choix. A leur éviction, à leur misère, à leur rôle trop souvent dicté par le passéisme, Annie Ernaux répond d’une salve de réflexions sur le sort, sur leur dignité à recueillir au sein du réel, et, les mots-clés de son univers romanesque trouvent ici une forte justification : les origines, la mère, l’enfant, la place, le rassemblement , la vie « qui se déroule », la terrible « humiliation infligée par les marchandises » aux plus indigents (qui doivent sans cesse calculer le moindre euro pour survivre) éclairent le parcours remarquable d’un écrivain qui n’écrit pas pour faire commerce ni une littérature facile mais pour révérer la vraie vie des autres.
*
 « Malgré Fukushima », sous-titré « Journal japonais », qu’Eric Faye (1963) donne à lire chez Corti, résonne très fort aussi du poids de l’expérience intime et voyageuse. Le voyage, au Japon, répétitif, attendu, vénéré, offre à l’auteur les occasions rêvées d’évoquer lieux, climats, rencontres, découvertes géographiques, senteurs, atmosphères et humeurs, quatre mois durant, le temps d’un séjour à la Villa Kujoyama, à Kyoto.
« Malgré Fukushima », sous-titré « Journal japonais », qu’Eric Faye (1963) donne à lire chez Corti, résonne très fort aussi du poids de l’expérience intime et voyageuse. Le voyage, au Japon, répétitif, attendu, vénéré, offre à l’auteur les occasions rêvées d’évoquer lieux, climats, rencontres, découvertes géographiques, senteurs, atmosphères et humeurs, quatre mois durant, le temps d’un séjour à la Villa Kujoyama, à Kyoto.
Sa fascination pour la culture japonaise, déclinée en théâtre, cinéma (ah ! Ozu), littérature romanesque et poétique (de Bashô à Oseki, en passant par Mori Ogai et les contemporains…), marionnettes, masques, vignettes visuelles, îles et ports, donne matière et densité à ce journal des périples et des rencontres. Les longues et lentes distances parcourues d’une grande île à l’autre, les moyens de transports, le quotidien des passages et des transhumances, la vérité des scènes (comme cet hôtel privilégié réservé pour une somme modique ; l’agacement devant les pertes de temps ; les craintes de voir une amie de la Villa perdre son travail…) : on frôle sans cesse les nœuds d’une expérience qui se veut tout à la fois originale, précise, précieuse, unique : il faut, qu’à l’image d’un Bouvier ou de tout grand voyageur, Lacarrière, par exemple, l’auteur puisse tirer un profit exemplaire de ses nombreux déplacements dans un pays où il faut sans cesse décoder les atouts ( on n’est pas loin de Barthes ni de son Empire des signes).
Le petit livre, profondément, chapitre après chapitre, au fil des saisons, s’insinue dans notre propre expérience qu’il nourrit : on retrouve avec adoration cette figure du cinéaste Ozu et la place qu’occupe « Voyage à Tokyo » dans l’histoire du cinéma et des spécialistes comme les 358 filmologues interrogés par Sight&Sound pour établir la liste des dix meilleurs films de tous les temps (à ce propos, une petite erreur de Faye :le film d’Ozu n’est pas classé premier mais troisième lors du classement de 2012).
On découvre aussi l’intérêt de certains grands traducteurs, comme Yoshikawa, qui s’est attelé à la traduction de toute « La Recherche ».

C’est avec mélancolie que l’on quitte ce beau témoignage des voyages intérieurs d’un écrivain doué pour signaler la vie insolite à quelques milliers de kilomètres de son Limousin natal.
Le livre est si riche de références, de parcours, de vignettes photographiques (qui accompagnent le lecteur et le guident), de descriptions du réel japonais, que le lecteur prendra plaisir à le relire.
Une intime sensation des quatre éléments traverse la lecture et avec Eric Faye on traverse sous la pluie un pays enchanteur, parfois rugueux, parfois ancré dans une géographie des beautés orientales, parfois si éloigné d’une modernité dispensée en images d’Epinal.
Le grand voyageur parle très bien des us, des coutumes, des ports brumeux, du Bunraku d’Osaka, des fêtes, des lieux pour cinéphiles (hommage à « L’île nue » de Shindo…), de la solitude du voyageur, et parfois, de son inexpérience et des séquelles de tout voyage mal organisé. En quoi, lucidité et expérience tissent ici une matière d’apprendre et de retourner aux essentiels : la vie, l’autre et l’intense désir du voyage.
* Annie Ernaux, « Regarde les lumières mon amour », Seuil, 80 p., 2014, 5,90€.
* Eric Faye, « Malgré Fukushima », Corti, 160p., 2014, 19€.









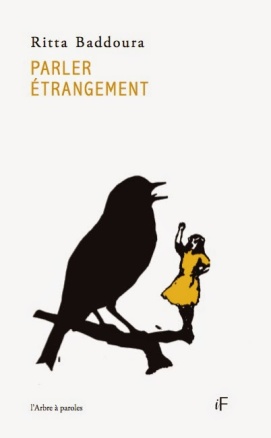

 Le saltimbanque des feuilles mortes
Le saltimbanque des feuilles mortes






 DU GÂTEAU!
DU GÂTEAU!
 MOURIR POUR MOURIR
MOURIR POUR MOURIR

 La tâche poétique va consister, « au gré des mots, de la parole », à convertir ces pertes de temps en « perles de temps ». Le poème dont « on ne sait presque rien » sinon qu’« on naît presque avec lui » désenfouira les souvenirs blottis dans le sable des jours.
La tâche poétique va consister, « au gré des mots, de la parole », à convertir ces pertes de temps en « perles de temps ». Le poème dont « on ne sait presque rien » sinon qu’« on naît presque avec lui » désenfouira les souvenirs blottis dans le sable des jours.  Annie Ernaux, que « La Place », « Journal du dehors » ou autres « Les Années » ont rendue célèbre, et à juste titre, tant on adhère à cet univers aigu, entre remémoration familiale, acuité sociologique pour percevoir l’autre et écriture splendide de densité vraie, publie au Seuil son journal d’Auchan.
Annie Ernaux, que « La Place », « Journal du dehors » ou autres « Les Années » ont rendue célèbre, et à juste titre, tant on adhère à cet univers aigu, entre remémoration familiale, acuité sociologique pour percevoir l’autre et écriture splendide de densité vraie, publie au Seuil son journal d’Auchan.
 « Malgré Fukushima », sous-titré « Journal japonais », qu’Eric Faye (1963) donne à lire chez Corti, résonne très fort aussi du poids de l’expérience intime et voyageuse. Le voyage, au Japon, répétitif, attendu, vénéré, offre à l’auteur les occasions rêvées d’évoquer lieux, climats, rencontres, découvertes géographiques, senteurs, atmosphères et humeurs, quatre mois durant, le temps d’un séjour à la Villa Kujoyama, à Kyoto.
« Malgré Fukushima », sous-titré « Journal japonais », qu’Eric Faye (1963) donne à lire chez Corti, résonne très fort aussi du poids de l’expérience intime et voyageuse. Le voyage, au Japon, répétitif, attendu, vénéré, offre à l’auteur les occasions rêvées d’évoquer lieux, climats, rencontres, découvertes géographiques, senteurs, atmosphères et humeurs, quatre mois durant, le temps d’un séjour à la Villa Kujoyama, à Kyoto.