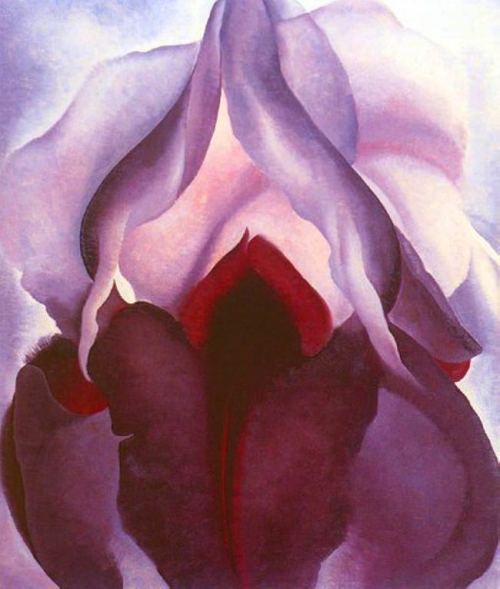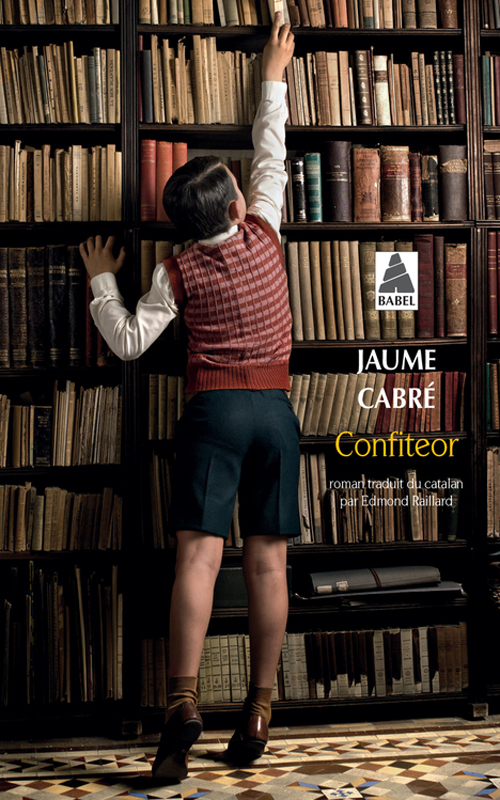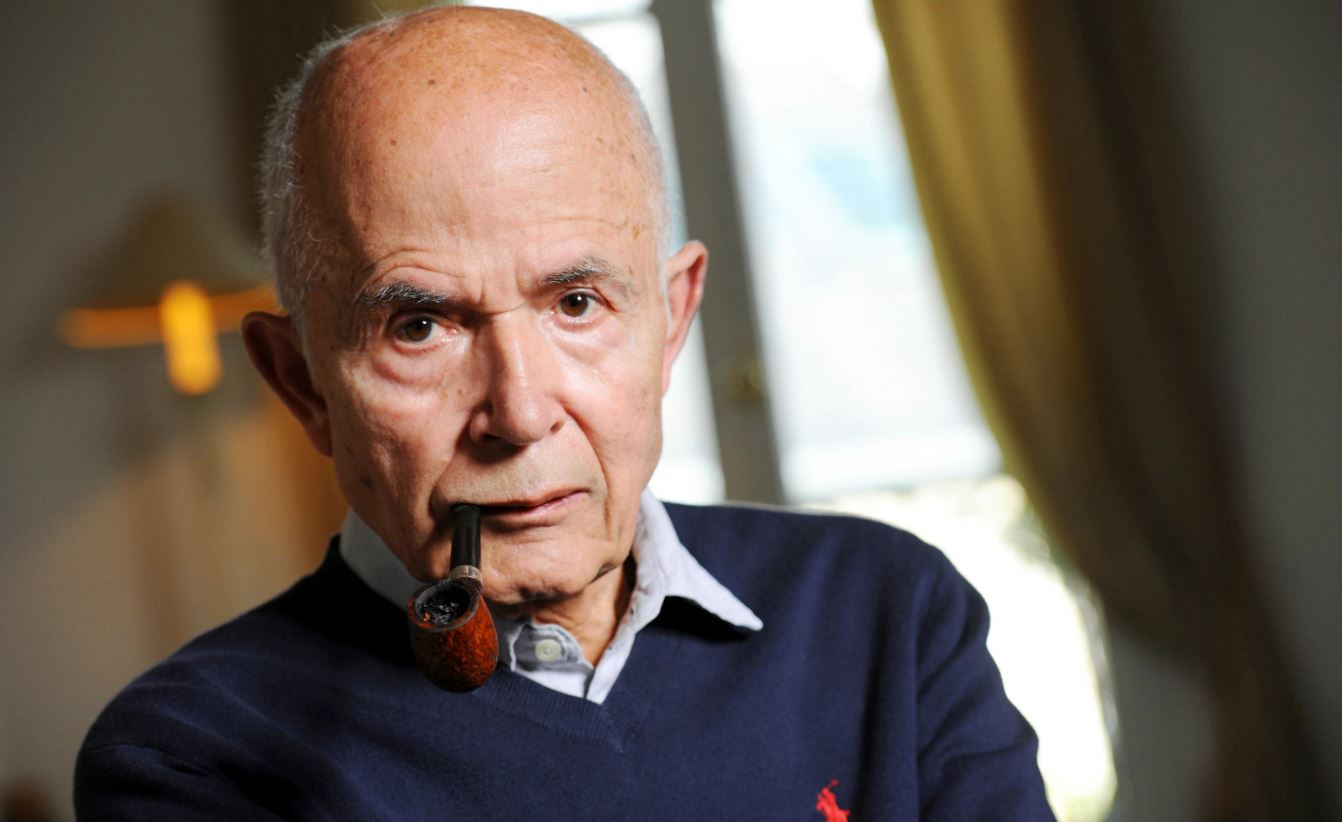La Chambre de Jacob est un roman insolite, perturbant et profondément envoûtant. L’ayant lu peu avant mes vacances, je viens de le relire cédant à l’ appel de ce monde fragmenté qui aurait les mille reflets aléatoires des éclats de verre d’une lanterne magique brisée : la réalité est là mais aussi volatile que la pensée et dont le sens – s’il y en a un – ne peut davantage être anticipé que la direction d’un vol de moucherons, une fin d’après-midi orageuse. Ce roman est le premier de la « veine expérimentale » de Virginia Woolf.

Dans la lecture que j’en fais, je ressens les différents fragments qui composent ce livre comme autant de plans qui, chacun, pourraient donner naissance à un autre récit et dont l’unité vague qui les relie dérive de cette chambre, lieu géométrique d’une existence largement insaisissable.
Dans l’atmosphère qui pour moi se dégage de cette œuvre, le chapitre d’ouverture prend les allures d’un film muet des débuts du cinéma.
Ce sont les dernières années de la Belle Epoque. Une jeune veuve, Betty Flanders, séjourne sur les côtes de la Cornouailles en compagnie de ses trois enfants, les aînés Jacob et Archer et le plus jeune qui vient de naître.
Nous sommes à la plage en début d’automne: je visualise cette scène en noir et blanc, à la fois statique et heurtée (comme tout le livre) : Betty est assise sur le sable clair sur lequel elle a étendu en guise de couverture, un manteau sombre. Elle porte un chapeau de paille maintenu par une épingle. Légèrement en retrait un peintre a planté son chevalet et croque la scène. Nous sommes en fin de journée, le temps change : le peintre ajoute sur sa toile une touche de noir au ciel. Archer déboule : apeuré et triste, il cherche son frère : « Ja-Cob !Ja-–Cob ! ».
Betty se lève, secoue le sable de son manteau, ramasse son ombrelle noire. On retrouve Jacob plus loin dans les dunes. Dans son sceau de plage, dans un fond d’eau, de sable et de débris de coquillage, un crabe aux mouvements lents. Dans son autre main, Jacob tient une mâchoire de mouton comme polie par le sable : toute blanche et plantée de dents jaunes. La famille rentre dans le petit cottage tout proche. Le soir, le vent s’est levé. La pluie frappe les vitres et dehors dans le jardin, dans le petit sceau d’enfant à moitié rempli par la pluie, le crabe tourne en rond, essaye d’en escalader le bord abrupt, « essayant de nouveau puis retombant, et essayant encore et encore ».
Fin du premier plan. La vie de Jacob peut commencer. Nous le suivons à Cambridge, puis dans les différents lieux de son occupation dans Londres mais toujours dans cette chambre dont il déménage plusieurs fois mais où l’accompagnent une table ronde et deux fauteuils bas en osier, bon nombre de livres et cette mâchoire de mouton, souvenir d’enfance et symbole de mort.
De Jacob, le roman, comme la vie de chacun de nous, dévoile peu et beaucoup à la fois. Nous savons qu’il est grand, bien bâti mais d’une constitution qui l’âge venant pourrait le porter à l’embonpoint ; que bien qu’il ait l’air très distingué, tous – mais surtout les femmes – le jugent terriblement gauche. Son rapport aux femmes entremêle passion, indifférence, connivence intellectuelle, brusquerie et penchant pour les liaisons tarifées. Son meilleur ami est un homosexuel : une amitié fidèle mais peu expansive et comme incompréhensible à l’un comme à l’autre les unit jusqu’au bout.
Personnage principal du roman, Jacob est donc largement insaisissable. Il illustre de manière exemplaire une forme d’incommunicabilité ressentie très profondément par Virginia Woolf. Nous sommes tous comme ces voyageurs de l’impériale qu’elle décrit. Ils peuvent seulement se dévisager un instant avant de se perdre, parfois pour toujours.
« Mr Spalding regarda Mr Charles Budgeon. (…) Chacun avait ses propres soucis en tête . Chacun avait en lui son passé enfermé comme les feuilles d’un livre qu’il connaissait par cœur ; et ses amis ne pouvaient lire que le titre, James Spalding ou Charles Budgeon, et les passagers allant dans la direction opposée ne pouvaient rien lire du tout – sauf « un homme avec une moustache rousse », « un jeune homme en gris fumant la pipe ». (…) Le petit Johnnie Sturgeon dégringola l’escalier (…) et courant en zigzag pour esquiver les roues, il atteignit le trottoir, se mit à siffler un air et fut bientôt perdu de vue, pour toujours. »
Jacob tombe plusieurs fois amoureux. Toutefois les sentiments ne semblent pas être son fort ; en tout cas nous n’y avons pas accès. Vu à la dérobée, « Jacob a l’air paisible, non pas indifférent mais semblable à quelqu’un sur une plage, l’œil observateur ». Précisément, dans ce roman, le lecteur se fait un peu l’impression d’être sur une plage un beau jour de juillet. Il fait beau, vous fermez les yeux : vous êtes comme isolé au cœur même de la multitude. Le murmure de la mer, les appels des marchands ambulants, les sonneries de trompe des sauveteurs, les cris des jeunes filles, et tout près des bribes de phrases qui vous parviennent, incomplètes, dépourvues de leur sens global mais très claires par la magie de l’air. Ainsi dans ce roman, aucun dialogue n’est véritablement mené à son terme: subsistent seulement les traces d’un échange déjà éternel puisque rien ne fera qu’il n’ait pas eu lieu, mais comme fossilisé dans un temps évanescent, impossible à reconstituer dans sa mobilité et sa spontanéité. Virginia Woolf se fait l’écho d’un monde dont le sens (d’ailleurs sans réel intérêt) se perd dans la profusion de sa polyphonie. Tous les plans du roman s’ouvrent les uns sur les autres, sans unité autre parfois que ce lieu où réside Jacob. Comme si ce monde disparate et en expansion ne cessait jamais « d’avoir pour centre, pour pierre d’aimant, un jeune homme seul dans sa chambre »..
Peu avant sa mobilisation pour la Grande Guerre, dont, comme le jeune frère tendrement aimé de Virginia Woolf, il ne reviendra pas, Jacob entreprend un long périple qui doit le mener à Rome puis à Athènes et son Parthénon, « stupéfiant de calme silencieux, si puissant que, loin d’être délabré, il semble au contraire, devoir survivre au monde tout entier ». Il y a quelque chose qui fait songer à Hypérion dans ce retour aux sources en cette patrie des patries, à la veille de l’embrasement général.
Jacob ne reviendra pas des Flandres. Il sera tué dans les premiers jours de la guerre. Pour peu de temps encore cette chambre que ses proches sont venus ouvrir, gardera sa trace comme lorsqu’il partait en voyage.
« L’air languit dans une chambre vide à peine fait-il se gonfler le rideau ; les fleurs dans un pot bougent. Une fibre du fauteuil d’osier craque, bien que personne n’y soit assis ».