
FIN DE L’EPISODE PRÉCÉDENT
A l’approche de la clinique, tout juste un dispensaire d’après ce qu’il vit plus tard, Damon devenait plus nerveux, il ne savait pas comment régler cet affrontement qui dressait ces deux excellents professionnels l’un contre l’autre. Comme souvent, le manque de travail génère l’ennui, du temps à meubler, à meubler avec des femmes, avec des femmes qu’on se dispute pour être celui qui aura les faveurs de celle qui fait rêver les mâles du secteur. C’est le retour au règne animal, l’homme chasse la femelle mais, bien souvent, la femelle choisit son compagnon. Il ne voulait surtout pas se mêler de cette rivalité, il avait accepté cette expédition car elle le conduisait dans le bush, là où il avait fort envie d’aller, et plus particulièrement en direction du nord-est, en direction du Namaqualand dans cette partie sauvage du veld où Zoë Wicomb était née et où elle l’attendait dans une ferme qui aurait pu être celle de son amie, Frieda Shenton, partie étudier en Europe et mal reçue à son retour.
ÉPISODE 34

Zoé Wicomb
Elle était installée sur la terrasse, sous un arbre qui dispensait généreusement son ombrage en espérant la protéger du mieux qu’il put de la chaleur qui régnait alors. Elle semblait l’attendre bien qu’il n’ait même pas fixé la date de son arrivée tant le voyage lui semblait, de son bureau quand il préparait son périple, aléatoire et hasardeux. Mais, finalement, le voyage n’avait pas été si compliqué qu’il l’avait craint et il avait atteint cette ferme dans les délais approximatifs qu’il s’était fixés. Elle l’accueillit avec beaucoup de chaleur et d’amitié, l’invitant à se désaltérer d’abord, à se restaurer ensuite et enfin à prendre un petit repos avant toute autre activité. Il avait une envie folle de gambader dans les hautes herbes comme le faisait régulièrement Frieda, chaque fois qu’elle revenait à la campagne, pendant les vacances scolaires. Il savait bien cependant qu’il n’avait plus l’âge de se livrer à de tels exercices et qu’il devrait se contenter de quelques promenades dans le bush avec son amie. Mais avant tout, il fallait reprendre des forces.
Zoë l’avait accompagné à travers les herbes à éléphant qui envahissaient cette partie du bush, vers un petit vallon qui accueillait autrefois Frieda quand elle était trop en manque de son pays, elle entrait alors en communication avec la terre qu’elle considérait sienne, comme une mère qu’on ne peut partager qu’avec ceux qui la reconnaissent aussi comme telle. Elle écoutait chanter la petite source qui la berçait dans la douce quiétude qui la baignait et qui la ramenait à son enfance dans ce pays enchanteur. Il fallait être né dans ce pays pour y vivre avec une telle intensité, certes son climat pouvait être très chaud mais en général il était agréable et toujours supportable. Il fallait surtout avoir le courage de se confronter avec une nature exubérante, primaire, indomptée qui ne s’offrait qu’aux âmes puissantes. Frieda aimait cette nature altière qu’il fallait affronter comme un animal sauvage, sans crainte, les yeux dans yeux. Elle était, ainsi, devenue une véritable femme du bush que même ses études à la ville n’avaient pas ramollie. Et pourtant…
Pourtant, elle n’était pas toujours acceptée comme telle, certains lui reprochaient son abandon de la campagne, son départ pour la ville, ses envies de carrière qu’ils interprétaient comme une forme de dédain envers le petit monde du veld. D’autres pensaient qu’elle ne serait jamais des leurs, qu’elle resterait la petite métisse qu’elle était et que la tache originelle était indélébile. Elle avait une part de sang noir qui la séparerait toujours d’eux. Zoë était assise à ses côté, un peu triste, « Tu vois dit-elle, ils n’ont pas voulu d’elle et aujourd’hui cette ferme est vide et le pays quasi désert ». « Tout cela est bien triste » ajouta-t-il. Ils reprirent leur chemin, ils voyaient une jeune fille brune, bronzée qui courait dans les herbes folles à perdre haleine et qui riait, riait, riait… image d’un temps révolu, image d’un bonheur brisé.
Son séjour était bien trop court tant il aimait ce pays qui semblait l’avoir adopté, mais son amie devait rentrer en ville pour assurer ses activités et lui devait poursuivre son périple vers une autre partie du bush, dans l’Etat d’Orange, où Karel Schoeman l’attendait pour un de ces jours prochains que les aléas du voyage se chargeraient bien de fixer sur le calendrier. Il quittait ce petit coin du Namaqualand le cœur serré mais il avait, dans une autre poche de son coeur, une folle excitation à l’idée de retrouver un autre paysage fastueux et un ami rencontré en Suisse quelques années auparavant.

Karel Schoeman
Et, désormais, il était là avec cet ami assis sur les marches d’une vieille ferme presque abandonnée où ils avaient pu, tous les deux, trouver un hébergement assez sommaire. Ils s’étaient retrouvés avec plaisir mais Karel ne débordait pas de joie, il semblait triste, des idées sombres l’agitaient.
– Karel, quelque chose ne tourne pas rond ?
– Je ne sais pas, il y a un drôle d’ambiance ici, il se passe des choses bizarres.
– Tu as vu, entendu, senti des choses anormales ?
– Oui, non, je ne sais pas bien !
– Explique !
– Les gens sont aimables et même gentils mais ils semblent me fuir.
– Tu es venu ici pour une raison particulière ?
– Bien sûr, je devais recevoir l’héritage de mes parents maintenant décédés, une vieille ferme en mauvais état, mais je n’arrive pas à savoir seulement où elle est, dans ce village mais je ne sais pas où !
– Personne ne veut te le dire ?
– Personne ! Tout le monde fuit la question, l’évite, l’élude, comme si elle brûlait la langue et les oreilles !
– Tu as une idée ?
– Les gens sont très malheureux ici, beaucoup partent, la pression sur eux est très forte, alors ils se regroupent pour faire des fêtes et se regonfler le moral ; mais j’ai l’impression que ces fêtes cachent des actions moins innocentes.
– Quoi à ton avis ?
– Je ne sais pas exactement mais les fermiers se sentent abandonnés, pas en sécurité, à la merci de certaines bandes d’anciens employés et ils ressassent des événements du temps passé qu’il ne faut surtout ramener à la surface.
– La ségrégation n’est pas morte !
– Non, il reste de nombreuses empreintes notamment dans ces campagnes éloignées des grandes villes. Les fermiers craignent d’être la cible de certains revanchards qui voudraient régler des vieux comptes.
– Et ta maison là-dedans ?
– Il a dû se passer, là-bas, quelque chose pendant la période trouble, quelque chose qui aurait laissé des traces, des stigmates, qu’il ne faut surtout pas voir.
– Tu vas rester ici ?
– Oui, je veux savoir, je veux savoir si ma famille est impliquée !
– Bon courage !
– Je n’ai pas l’intention d’écrire l’histoire à l’envers, ce qui a été, a été, inutile d’y revenir mais je voudrais savoir pour savoir mais aussi pour que la situation ne dégénère pas à nouveau. Les fermiers complotent, ils sont aux abois, ils se dissimulent mal. J’ai peur qu’ils dérapent dans la violence et que des drames entachent à nouveau cette région.
– Le désespoir semble le principal habitant de cette petite bourgade ! Il faudra encore du temps avant que l’histoire locale s’écrive enfin dans la paix.
– Quelques générations peut-être !
Il avait rarement vu un tel désespoir, il était abattu de laisser son ami dans cette situation, il culpabilisait comme si un drame avait déjà éclaté. Il espérait vivement que le pouvoir prenne en considération ces pauvres hères isolés, perdus dans d’une population qui ne les aimait pas beaucoup et qui pouvait même, dans quelques cas isolés, devenir plutôt agressive. Mais il voulait se rassurer en pensant que la grande majorité ne voulait plus que la paix et l’égalité.
La paix ils l’avaient eue, eux les métisses afro-asiatiques, mais l’égalité ils pouvaient toujours attendre pour que les nouvelles lois égalitaires soient transposées dans les mentalités. C’était l’avis d’Achmat Dangor, un métisse lui-même, qui avait subi toutes les humiliations que les non blancs avaient dû supporter avant la fin de l’apartheid, il avait même été banni pendant de longues années. Et ils étaient là, tous les deux, assis à la terrasse d’un café de Joburg, comme disait son ami pour évoquer la ville de Johannesburg, profitant des nouvelles libertés acquises depuis la fin de la ségrégation mais se désolant que, malgré leurs activités souvent commerciales et lucratives, ils soient régulièrement humiliés, rabaissés, privés de droits élémentaires. Certes, l’argent leur apportait certaines satisfactions mais il devait régulièrement faire face à la morve de ceux qui avaient le plus profité du régime racial, et qui prenait un réel plaisir à les rabaisser en leur refusant une affaire, la main d’une fille, un délai, un report de dette, un prêt, une facilité quelconque, … ils n’avaient pas droit à ce que ces blancs considéraient comme leur domaine protégé, leur chasse gardée. Il faudrait encore bien des générations avant qu’une société multiraciale et égalitaire s’instaure définitivement à la pointe de l’Afrique.

Achmat Dangor
Ils discoururent encore longuement de tous les malheurs, infamies et humiliations que les asiatiques et les métisses avaient dû supporter, peut-être à un autre degré que les noirs, mais tout de même suffisamment pour faire d’eux une catégorie humaine inférieure à celle des blancs et les tenir hors de la caste des êtres qui se prétendaient supérieurs. Il profita de cette conversation pour lui demander des nouvelles des expériences tentées par Bessie Head, une autre métisse, qui avait choisi, elle, de s’exiler dans ce pays qui n’était pas encore le Botswana et qui n’était alors que le Bechuanaland, un vaste territoire sous contrôle britannique. Il n’eut pas le temps de comprendre la réponse de son ami, son téléphone sonnait dans poche et, mécaniquement, il l’extirpa :
– Allo, Monsieur…. (une voix manifestement étrangère qu’on aurait dite contrainte pour essayer d’oublier son accent vernaculaire, identifiait clairement une de ces nombreuses plateformes téléphoniques qui passaient leur temps à importuner des braves gens pour leur vendre n’importe quel produit ou service dont tout le monde pouvait se passer sans aucun problème.)
– Oui !
– Allo, Monsieur vous êtes bien retraité et vous habitez bien dans une maison individuelle ?
– Mais, cher Monsieur, cela ne vous regarde en rien, je ne vous ai pas demandé si vous aviez moins de trente ans et si vous habitiez toujours chez vos parents !
– Mais Monsieur…
– Maintenant la plaisanterie a assez duré et vous direz à vos employeurs de vous procurer des messages plus corrects, on ne s’invite pas comme ça chez les gens pour leur poser des questions indiscrètes ! Bonsoir Monsieur ! (et il raccrocha rageusement).
Il s’était encore laissé surprendre par un de ces cons qui passaient leur temps à lui pourrir la vie, ses siestes, ses rêves, ses évasions et son voyage au Botswana avec Bessie Head. Il était en colère, il ne supportait plus ces importuns qui venaient troubler sa paisible vie de retraité et qui tentaient, pas très correctement de plus, d’extorquer quelques sous à des gens soi-disant moins démunis et souvent plus faciles à apitoyer. On avait essayé de lui vendre les pires choses, des fenêtres tous les trois jours comme s’il en changeait toutes les semaines, toutes sortes de prestations téléphoniques auxquelles il ne comprenait rien, de l’énergie (en boîte ?), du vin qu’il devait être impossible de vendre après dégustation et même récemment des obsèques organisées comme un défilé du quatorze juillet. Il avait à peine ri, il était choqué, il fallait avoir un esprit mercantile particulièrement développé pour oser dire à une personne, plus près de sa fin que de son épanouissement, qu’il fallait qu’elle songe à choisir entre le chêne et le sapin pour ne pas laisser ce cruel dilemme à ses héritiers. Il avait purement et simplement raccroché, trop soufflé pour proférer la moindre réaction. S’exclamant pour lui seul : « les cons ! »
Décidément ce monde était déjà bien pourri, il y avait déjà pas mal de véreux dans le fruit. Il avait perdu le contact avec le Botswana, il se prépara donc une tasse de thé pour évacuer les dernières brumes de sa sieste africaine et profiter des premiers rayons de soleil printaniers pour se dégourdir les jambes avec une petite balade dans la campagne avoisinante. Il prit donc le sentier qui courait le long de la colline et dominait le paysage, un paysage qui revenait à la campagne originelle, où les cultures avaient été abandonnées, une belle victoire pour la nature sauvage mais certainement un problème majeur pour les pauvres populations qui vivaient encore là.

J. Nozipo Maraire
– Nozipo, la nature a retrouvé sa parure originelle.
– Oui, hélas !
– Pourquoi, hélas ?
– Parce qu’ici, avant, il y avait de belles cultures et des gens pour planter, semer, entretenir, récolter, …, et maintenant ces campagnes sont en friche, elles ne donnent plus rien, les habitants partent et ceux qui restent ont faim.
– Tu sembles bien pessimiste !
– Et encore plus que tu le crois !
– A ce point !
– Oh oui ! J’aurais dû mieux écouter ma mère, quand je suis partie aux Etats-Unis pour faire mes études, elle m’a écrit une longue lettre pour me dire tout ce qu’elle n’avait pas pu, ou su, me dire avant et je n’ai pas écouté avec suffisamment d’attention le message qu’elle m’adressait. Et, aujourd’hui, inutile de relire ce qu’elle écrivait, j’ai ce message, là, inscrit sous mes yeux tous les jours depuis que je suis revenue au pays pour voir comment il allait réellement.
– Et ce message ne comporte pas beaucoup d’espoir ?
– Bien peu. Ma mère m’a raconté mon peuple, son histoire, la vie difficile dans la brousse, l’esclavage, nos traditions, … tout ça, je le garde dans mon cœur, dans mon sang, dans mes tripes, … à jamais. Mais elle nous a dit aussi que l’indépendance a été un dur combat, un combat que nous n’avons pas su transformer en victoire. Nous avons copié les blancs, nous les avons singés, mais nous n’avons pas su retrouver notre africanité et imposer nos valeurs et notre culture. Nous nous sommes contentés de la vengeance et des règlements de compte en bradant les plus beaux fruits de notre pays aux nouveaux colons, ceux qui ne s’intéressent qu’aux richesses qu’ils accaparent prestement, en passant.
– Le pouvoir a failli ?
– Pas que le pouvoir, nous tous avons failli, ma mère m’avait pourtant bien dit que, nous les élites, nous avions un devoir envers notre pays et nous ne l’avons pas écoutée comme nous n’avons pas entendu tous les sages de ce pays. Nous avons laissé les responsabilités aux ambitieux, aux assoiffés de pouvoir et d’argent qui ont remplacé les colons sans apporter un iota de plus ; au contraire, ils étaient assez médiocres pour se mettre au service de tous les trafiquants qui arpentent l’Afrique dans tous les sens pour accaparer ses richesses.
Il ne pouvait qu’acquiescer, il ne trouvait rien à opposer à cette analyse, la campagne qu’il traversait maintenant, du côté de Bulawayo, au sud du Zimbabwe, là où est née Nozipo Maraire qui l’accompagnait dans cette promenade au travers des champs qui avaient même perdu le souvenir des cultures que des fermiers venus d’ailleurs y avaient fait prospérer. La brousse retrouvait son aspect sauvage et fier, les fermiers avaient été expulsés ou étaient partis avant de se faire renvoyer ou même maltraiter. Seuls quelques uns résistaient encore dans des coins perdus dans les collines. Les autochtones n’avaient pas su récupérer le savoir de ceux qu’ils renvoyaient et la nature ne produisait plus rien pour les pauvres gens qui essayaient encore de vivre dans cette brousse.

À suivre…
 Le Grand Maître des Élastiques avait auparavant exercé les fonctions de Maître des Cordes. À la contrainte des formes, à la rigidité des lignes, il avait préféré la transformation des volumes, l’incurvation des droites et l’assouplissement de la ligne. Un corps enfermé dans des cordes savamment entrelacées en est entièrement prisonnier : pas moyen de remuer un doigt, un cheveu ; aucune ligne de fuite, aucun jeu n’est permis. Dans sa nouvelle discipline, le Grand Maître distendait les murs, les frontières. Plus aucun barrage ne s’opposait à ses projets. Sous son action, les cartes bientôt se déformaient, les territoires s’étendaient. Il allongeait les langues des humains, mais aussi leurs membres : bras, jambes et appendices divers. Il les faisait toucher les nuages et baigner dans des puits artésiens, des fosses abyssales. Sous son action, le monde n’était plus fait que de matière caoutchouteuse, extensible à souhait. Les marionnettes humaines se dilataient aussi bien qu’elles se rétractaient, reprenant ses dimensions originelles après un temps d’élargissement maximal. Mais il pouvait aussi très vite réduire à rien tout ce bazar. L’homme n’avait plus de mesures propres. Il pouvait aussi bien s’élargir à l’échelle du cosmos ou se rapporter aux dimensions d’un fétu de paille. Extension, relâchement. Les textes aux lettres défigurées ne signifiaient plus rien, les dessins d’art devenaient des brouillons informes. Le langage des étoiles ânonait le jargon des atomes.
Le Grand Maître des Élastiques avait auparavant exercé les fonctions de Maître des Cordes. À la contrainte des formes, à la rigidité des lignes, il avait préféré la transformation des volumes, l’incurvation des droites et l’assouplissement de la ligne. Un corps enfermé dans des cordes savamment entrelacées en est entièrement prisonnier : pas moyen de remuer un doigt, un cheveu ; aucune ligne de fuite, aucun jeu n’est permis. Dans sa nouvelle discipline, le Grand Maître distendait les murs, les frontières. Plus aucun barrage ne s’opposait à ses projets. Sous son action, les cartes bientôt se déformaient, les territoires s’étendaient. Il allongeait les langues des humains, mais aussi leurs membres : bras, jambes et appendices divers. Il les faisait toucher les nuages et baigner dans des puits artésiens, des fosses abyssales. Sous son action, le monde n’était plus fait que de matière caoutchouteuse, extensible à souhait. Les marionnettes humaines se dilataient aussi bien qu’elles se rétractaient, reprenant ses dimensions originelles après un temps d’élargissement maximal. Mais il pouvait aussi très vite réduire à rien tout ce bazar. L’homme n’avait plus de mesures propres. Il pouvait aussi bien s’élargir à l’échelle du cosmos ou se rapporter aux dimensions d’un fétu de paille. Extension, relâchement. Les textes aux lettres défigurées ne signifiaient plus rien, les dessins d’art devenaient des brouillons informes. Le langage des étoiles ânonait le jargon des atomes. 


















.gif)





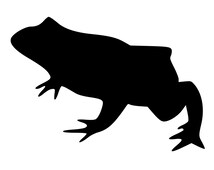

















 « La Fille devant soi »
« La Fille devant soi » 





 LES TEXTICULES DU DIABLE
LES TEXTICULES DU DIABLE
 SANS ENVIE DE RIEN
SANS ENVIE DE RIEN















 D’un jeune écrivain, mort à trente-deux ans, en pleine ère néo-réaliste, Ezio Comparoni, connu sous le pseudonyme de Silvio D’Arzo, ce court roman, paru à plusieurs reprises (en 1952, 1953, 1960, 1980, 1981, 1988 pour cette version française due à Bernard Simeone et Philippe Renard, traducteurs, italianistes accomplis, tous deux partis trop tôt), se distingue d’emblée par une écriture d’une sobriété, d’une densité, d’une pureté, d’une transparence exceptionnelles.
D’un jeune écrivain, mort à trente-deux ans, en pleine ère néo-réaliste, Ezio Comparoni, connu sous le pseudonyme de Silvio D’Arzo, ce court roman, paru à plusieurs reprises (en 1952, 1953, 1960, 1980, 1981, 1988 pour cette version française due à Bernard Simeone et Philippe Renard, traducteurs, italianistes accomplis, tous deux partis trop tôt), se distingue d’emblée par une écriture d’une sobriété, d’une densité, d’une pureté, d’une transparence exceptionnelles.
