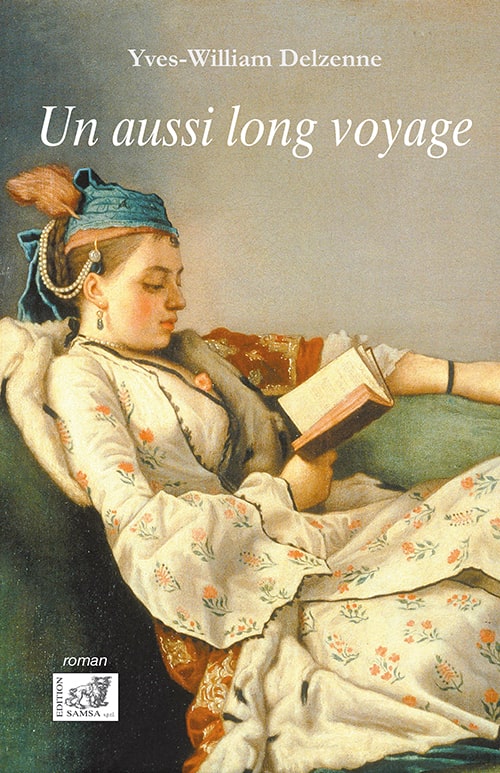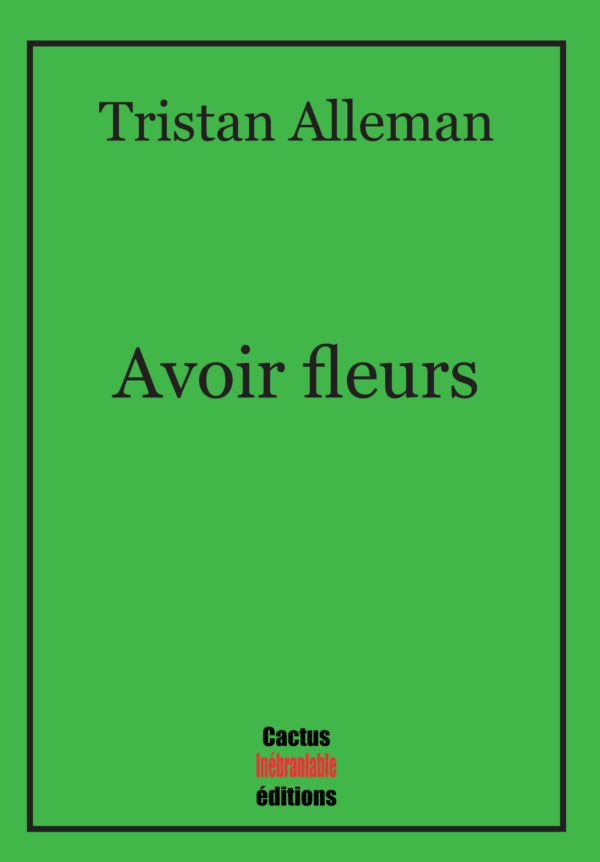A
Abusivement, montrer ses dents de lait pour effrayer une langue de veau.
Abondamment, recueillir le jus de l’absence avant de se presser pour partir.
Abominablement, rejeter la faute de coût sur le prix des saveurs.
Abstraitement, écarter les yeux du rivage pour voir la mer.
Actuellement, bourrer la rosace de la guitare de chants d’église.
Admirablement, parler le langage des fleurs en étant sourd comme un pot.
Aléatoirement, jouer aux dés avec des cubes de dérangement.
Alertement, arrêter l’arrivée d’aube à la sortie de la nuit.
Agilement, passer du coq à l’âne à la vitesse d’une poule poursuivie par un p(a)on.
Algébriquement, éteindre la chandelle d’une équation en mouchant l’inconnue.
Amèrement, sortir du lot des déprimés avec un prix de consolation.
Amèrement, voir le monde avec les yeux d’un mangeur d’endives.
Amoureusement, s’enmetoofler contre le flanc d’un porc.
Alternativement, aimer son prochain et maudire sa mémoire.
Anticipativement, prévoir le sujet du regard pour objecter ses vues.
Anxieusement, taper sur le nerf de la guerre pour battre le rappel des veines.
Apparemment, se prêter au jeu de la transparence derrière un mur de convenances.
Audacieusement, enlever ses verres de contact au moment d’embrasser le vide.
Audacieusement, sortir la tête du stable pour renverser l’autruche.
Aveuglément, porter des lunettes de soleil le jour de son enterrement.
Azurément, défendre l’atmosphère contre une attaque de nuages pâles.
B
Bassement, servir à voir à un barman aveugle.
Bénévolement, donner sa vie pour une cause chère.
Benoitement, sortir du cadre du tableau pour se faire prendre en photo par le peintre.
Bêtement, se pendre au cou d’une girafe faute de clou de girofle.
Bestialement, s’accoupler avec un tigre de papier sur la muraille de Chine.
Bourgeoisement, s’en tenir au champagne et au caviar pour ne pas sombrer dans le prolétariat.
Bravement, piétiner les restes du monde de la couture avec des talons aiguilles.
Brièvement, rencontrer le chef du syndic de l’immeuble entre deux portes.
Bruyamment, boucher les trompettes de la renommée pour pénétrer le monde du silence.
C
Cahoteusement, porter le deuil d’un amortisseur mort.
Calmement, rabaisser le caquet de la tête de mule en lui faisant porter le bonnet d’âne.
Carrément, retirer le permis à ronds-points à un triangle circulant sans le théorème de Pythagore.
Cavalièrement, jeter la monture de lunettes de jockey aux oubliettes de l’histoire hippique.
Charnellement, prendre en étau le soleil entre ta peau et mes lèvres.
Chastement, frapper les lèvres de l’impie avec la tige épineuse d’une rose.
Chorégraphiquement, dire ce qu’on danse au spectateur de ballet.
Chrétiennement, récolter dans les troncs d’église des têtes d’islamistes mécréants.
Chronologiquement, enfiler le chas, arrêter les aiguilles, régler l’heure sur les mailles du tricot.
Clairement, délier les lampes pour qu’elles révèlent leur source de lumière.
Clairement, enfermer la clé des images dans une une armoire à glace.
Cliniquement, analyser la couleur des yeux de rêve de la chirurgienne qui va vous arracher le cœur.
Commodément, traverser sa scolarité à l’ombre des grands arbres de la connaissance.
Comparativement, se dire qu’à courir moins vite qu’une gazelle au galop on arrivera aux noces du sable et de la mer après la marée.
Confidentiellement, porter à la connaissance de la Sûreté de l’état l’endroit où se planque le doute.
Confusément, sortir du Quai des Brumes sur Le Port de l’angoisse pour un Drôle de Drame.
Conjointement, se faire du tort avant que le mariage de raison vienne.
Consciencieusement, ranger l’orchestre chinois à côté des baguettes.
Conséquemment, tomber d’une étoile pliante dans un sofa en forme de demi-lune.
Constamment, rejeter la faute de frappe sur le dos du correcteur maudit.
Continuellement, rappeler à la rivière ses devoirs de lavoir.
Contre-révolutionnairement, voir le monde autrement qu’on l’a rêvé.
Convulsivement, tordre les lettres de la beauté pour en exprimer toute l’esthétique.
Coquettement, polir les rives d’un corps d’eau avant qu’il ne déborde d’amour propre.
Courageusement, braver les sens interdits pour accéder à la grand’place de la lâcheté.
Courtoisement, sauter de la planche de salut en disant bonjour à la cantonade.
Craintivement, raser les murs de l’angoisse avec une barbe de trois jours.
Crânement, repousser les avances d’une prise de tête en prétextant une migraine.
Crépusculairement, écrire à distance respectueuse des étoiles de la littérature filante.
Cruellement, frapper d’amnésie un mémorialiste.
Curieusement, prendre le taureau par la corne du rhinocéros pour percer dans l’arène
Cyniquement, étourdir le mouton d’électeur avec des promesses cochonnes.
à suivre…